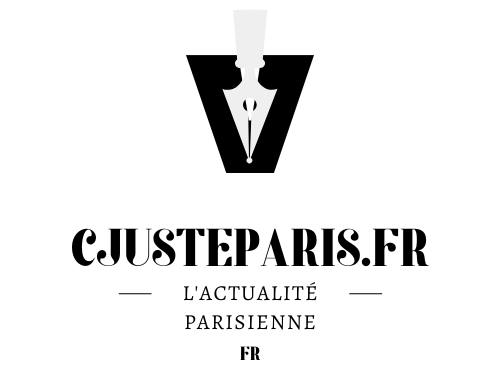Buenos Aires n’est pas Paris
Parmi les nombreux lieux communs sur Buenos Aires, un était inexact et personne n’en parle plus : que ça ressemblait à Paris. Depuis le dernier tiers du XIXe siècle, des modèles d’origine européenne différente ont été combinés. Trois grandes avenues se dessinaient ; certains d’entre eux rappellent fortement ceux de Madrid. Mais les grands édifices publics, véritables repères visuels, ne sont pas toujours d’inspiration française : il y a des façades néoclassiques, des façades à l’italienne, des façades éclectiques aux détails espagnols, voire des façades expressionnistes et modernistes. Dans les années trente, l’obélisque a été construit, un repère urbain qui représente Buenos Aires sur toutes les cartes postales. C’est un objet discrètement moderniste, orthogonal, blanc et étranger à toute marque qui rappelle les obélisques triomphaux de la capitale française.
Paris n’a jamais été le seul modèle européen pour Buenos Aires, même si l’architecture a donné le ton aux grandes demeures d’élite construites dans les dernières années du XIXe siècle et au début du XXe. Plusieurs idées de la ville, dont New York, la métropole américaine par excellence, ont fourni des images à réfléchir pour la ville du Río de la Plata. Au fur et à mesure que la modernisation progresse, la comparaison avec New York devient une perspective influente. Il y a un imaginaire populaire américain sous l’imaginaire européen. Mais New York et Paris sont, fondamentalement, des mythes urbains, des mythes au sens où Sorel utilisait ce mot, c’est-à-dire des « systèmes d’images » plutôt que des guides constructifs précis.
Le Corbusier a souligné comme propres à Buenos Aires les petites maisons construites par des artisans italiens, des maisons blanches et simples, qui pourraient être redirigées vers des formes géométriques élémentaires. Il a également souligné que, contrairement aux villes européennes traversées par leur fleuve emblématique (Rome, Londres, Florence, Paris, Budapest, etc.), Buenos Aires avait été construite de telle manière qu’à la fin des années 1920, la Se rendre à la rivière était presque impossible, car elle était séparée par des centaines de mètres d’arbres et de montagnes.
En vérité, Buenos Aires ne se souvient d’aucune ville européenne, mais elle est constituée de fragments prélevés sur nombre d’entre elles. Dans les quartiers les plus riches, nombreux sont ceux à la française, avec leurs toits en ardoise, mais ils ne donnent pas le ton de la ville, pas plus que la Maison du Gouvernement à l’italienne, l’éclectique Théâtre Colón ou le Congrès. L’image du style moderne discipliné de son premier gratte-ciel ou les traits anglais de ses gares prédominent. Le zoo de Buenos Aires est une miniature qui évoque le mélange stylistique de la ville qui l’abrite. On y trouve des pavillons normands, des pagodes, des serpentariums qui citent l’architecture industrielle ou les expositions universelles.
Le Corbusier a souligné comme propres à Buenos Aires les petites maisons construites par des artisans italiens, qui pourraient être redirigées vers des formes géométriques élémentaires.
La comparaison de Buenos Aires avec Paris (qui, d’ailleurs, n’est venue à l’esprit d’aucun Français) est une image du désir. Elle résulte du volontarisme politique et culturel des élites qui ont projeté la ville moderne depuis 1880. Probablement si ces hommes avaient été interrogés, ils auraient dit que Paris était la ville qu’ils admiraient le plus. Mais ces adhésions presque inévitables, car Paris était alors la ville la plus admirée du monde entier, se sont heurtées à des limites matérielles et des initiatives ont surgi qui ne se réduisaient pas simplement à la copie d’un modèle unique, mais à l’idée d’une ville. qui fonctionnerait comme pôle métropolitain, mercantile et moderne.
Le Buenos Aires que les élites ont imaginé et qu’elles ont en partie réussi à construire a un profil dont l’originalité réside dans la combinaison de différents modèles technologiques, urbains et esthétiques. Comme dans la culture argentine, l’originalité est dans les éléments qui entrent dans le mélange, piégés, transformés et déformés par un gigantesque système de traduction. La déception de la comparaison avec l’Europe était un obstacle pour reconnaître que cette ville monotone était techniquement plus européenne que beaucoup de celles qui avaient été visitées en Espagne et en Italie.
En effet, Buenos Aires possédait déjà à cette époque une ligne de métro (inaugurée en 1913), un port à l’ordre du jour, des rues pavées et pavées, des parcs dessinés par des paysagistes, de grands édifices publics, des égouts, des téléphones, et de l’électricité. Ce qui était d’ailleurs singulier, c’est que ces services étaient répartis de manière relativement équitable et touchaient les quartiers riches et pauvres. Le tracé des rues était en effet géométrique jusqu’à l’exaspération, car les élites avaient décidé de conserver le damier colonial et de l’agrandir, au lieu d’opter pour des tracés urbains plus intéressants, irréguliers et pittoresques.
Borges était peut-être le seul à percevoir dans les rues qui s’étendaient géométriquement jusqu’à l’horizon le véritable caractère de la ville nouvelle, ennuyeuse mais rationnelle. Il écrit en 1923, dans ces vers qui appartiennent, justement, à son poème « Arrabal » : « La banlieue est le reflet de notre ennui. / Mes pas se sont arrêtés / quand ils allaient marcher sur l’horizon / et je suis resté entre les maisons, / quadrillé en blocs / différents et pareils / comme s’ils étaient tous / souvenirs monotones répétés / d’un seul bloc » .
Le faubourg reprend en effet une disposition géométrique de blocs carrés formellement identiques à ceux du centre. Mais, précisément dans cette répétition, dans la fastidieuse similitude des rues droites qui se croisent à 90 degrés, Buenos Aires trouve une physionomie.
Abonnez-vous pour continuer à lire
Lire sans limites